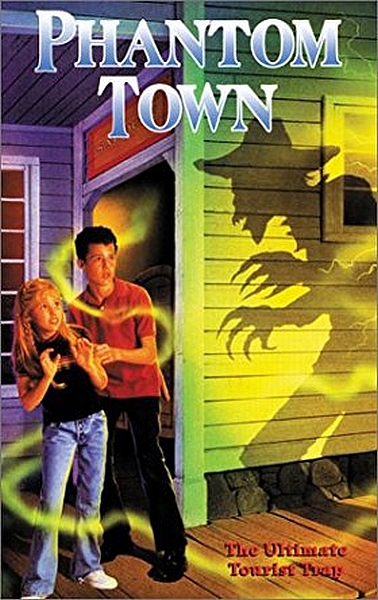
Phantom Town
(1998)

Avec Charles Band, rien n’est jamais simple et quiconque ne connait rien à ses méthodes risque d’être sérieusement confus en explorant son univers. Entre le renommage constant de sa compagnie (Full Moon Productions, Full Moon Studios, Full Moon Pictures, Full Moon Features) et ses multiples labels eux-mêmes retitrés au fils des ans (Torchlight Entertainement devenant Surrender Cinema, Alchemy Entertainement devenant Big City Pictures, Wizard Video devenant Cult Video – celui-ci ressortant les productions Empire, soit le proto-Full Moon), voir fusionnés ou abandonnés (Shadow Entertainement, Pulp Fantasy Productions, Monster Island Entertainment), il est facile de s’y perdre.
C’est encore pire lorsque ces bannières utilisent le nom de films produit par la compagnie, comme c’est le cas avec Pulsepounders, la nouvelle version de Moonbeam Entertainement, division “pour enfants” de la Full Moon (et qui a également connu de multiples étiquettes comme Filmonsters ou Action Xtreme). Car à la base, Pulsepounders est un film à sketches, une anthologie, datant de 1988 et jamais sortie, ayant accédé au statut d’œuvre culte avec le temps. Sur les trois histoires la composant, l’une ramenait les héros de Re-Animator (Jeffrey Combs, Barbara Crampton et David Gale, pour Evil Clergyman), et les deux autres étaient des mini-suites à des films déjà paru (City of Lost Angels, une séquelle à Trancers bien avant Trancers II, et une autre poursuivant l’intrigue de Dungeonmaster). Si Pulsepounders n’a jamais vu le jour en tant que tel, au grand dam des fans, ses sketches ont toutefois été restauré en 2011, Evil Clergyman et City of Lost Angels bénéficiant même de sorties exclusives pour l’occasion.

Entre l’annulation et la résurrection de cette anthologie, c’est le titre qui aura été recyclé. Sans logique visiblement, un film d’horreur pour adulte donnant alors son nom à une collection de films pour enfants ! Une décision bizarre à priori mais pas un cas unique: des noms de personnages de la saga Puppet Master par exemple, se mélangent avec ceux d’autres productions sans rapport (Totem, jouet égyptien maléfique, donnant vie à Totem, où des statuettes de pierre sacrifient des adolescents. A l’inverse Decapitron, petit robot à têtes interchangeables, fut reprit du projet abandonné Decapitron, un film de SF avec un cyborg de taille humaine jamais tourné… mais dont l’affiche a été utilisé en France pour vendre la VHS de Eliminators, un autre film de robots par la Full Moon. Tout le monde suit ?).
Bref, toute cette intro pour dire que c’est sous ce label Pulsepounders que sort Phantom Town – évidemment retitré Spooky Town quelques temps plus tard, sinon ce n’est pas drôle. Une œuvre qui réunit quelques comparses habituels de Charles Band puisque l’on y retrouve le roumain Vlad Paunescu, J.R. Bookwalter à la post-production et surtout le scénariste Neal Marshall Steven, connu sous le faux nom de Benjamin Carr (celui d’un compositeur du XIXème siècle !). Auteur très prolifique durant la deuxième moitié des années 90 et ayant signé parmi les meilleurs titres de la compagnie (Head of the Family, Hideous !, The Creeps, Shrieker, Retro Puppet Master, The Killer Eye, Sideshow, Stitches) mais aussi quelques mauvais (Talisman, Curse of the Puppet Master, Totem), il travaille au rayon enfant sans rechigner, y injectant même sa folie créative pour notre plus grand plaisir.

Car le type ayant créé un œil géant et violeur venu de la 8ème dimension, la version naine des Classic Monsters, une tête géante en fauteuil roulant doté d’une langue tentaculaire et une version primitive des pantins d’André Toulon bataillant contre des momies vêtues comme les Étrangers de Dark City sait ce que les mômes aiment: les trucs dégueulasses ! S’il freine sur l’horreur pure et la dimension sexuelle, il n’hésite donc absolument pas à balancer du slime vert à la tronche de ses personnages, à faire apparaitre mutants et morts-vivants décharnés, à taper dans des concepts carrément Lovecraftien (une ville entière qui est en fait une seule entité polymorphe à la The Thing) ni à faire dans le gore détourné (des bras sont arrachés, des visages défoncés, mais tout va bien car le sang est remplacé par une substance colorée).
C’est tant mieux pour les gamins, qui auront de quoi s’amuser comme dans un Fais-moi Peur ! ou une adaptation de Chair de Poule mais en plus osé, et surtout pour les adultes qui peuvent ainsi totalement faire abstraction des limitations du film (personne ne meurs, pas d’insultes ou de tensions) et avoir presque l’impression de se retrouver dans une production Full Moon normale. En fait j’irai même jusqu’à dire que Phantom Town tape plus fort que certaines productions “sérieuse” de la compagnie type Witchouse ou Killjoy: il y a ici un minimum de budget, de décors, de rebondissements et d’effets spéciaux pour faire illusion.

L’intrigue n’est pourtant pas exempt de défauts ou d’incohérences, sans doute la preuve que le script fut pondu en un jet alors qu’une réécriture aurait pu permettre de gommer ces soucis. Ainsi l’histoire se concentre autour d’une petite famille, un adolescent, son petit frère et sa petite sœur qui profitent de l’absence de leurs parents pour organiser une fête. Un coup de fil de leurs géniteurs les préviennent qu’ils ne devraient plus tarder à rentrer, étant dans l’immédiat perdu sur la route. Le lendemain, ils ne sont toujours pas là. Les heures passent et l’absence devient inquiétante, mais la police est incapable de gérer la situation et l’oncle et la tante des enfants ne savent pas quoi faire de plus. Nos jeunes héros décident d’agir et de retrouver eux-mêmes leurs parents, embarquant en voiture pour chercher l’endroit de leur disparition: un village énigmatique du nom de Long Hand, ne figurant sur aucune carte.
Leur trajet les mènent à une drôle de station essence tenue par un Indien mystique (parlant évidemment en métaphore et en énigme) qui leur explique que quiconque se rend là-bas ne peut en revenir, et que le seul moyen d’y accéder est à travers les rêves. Comprendre: s’endormir légèrement en conduisant ! C’est ce qui est arrivé aux parents et c’est ce qui arrive à leur rejetons, qui évitent miraculeusement une sortie de route mais se retrouve catapultés en plein Ouest sauvage. Long Hand est une parfaite réplique des villes de Western, sa population semblant avoir été bloquée aux années 1880 et ne comprenant rien à la technologie ou à la modernité.

Dès lors, la petite troupe explore les environs à la recherche des leurs et mettent à jour tout un tas d’éléments étranges: personne ne semble réagir à leur présence ni à leur différence, les habitants répètent les mêmes activités en boucle comme s’ils étaient coincés dans une boucle temporelle de quelques minutes, quant aux murs et au mobilier, il saigne lorsqu’on le dégrade: une étrange substance verte et visqueuse s’écoulant de tout et de n’importe quoi, et qui semble vivante.
Bientôt la vérité éclate et il se trouve que Long Hand n’est pas une ville mais une créature plus ancienne que l’humanité elle-même. Un monstre informe, sorte de blob pouvant absorber tout ce qui entre en contact avec lui et en assumer la forme. Au fil des siècles il a ainsi avalée le village américain ainsi qu’un territoire sacré Indien que l’on retrouve dans les souterrains, sortes d’archives mémorielles où sont conservés les “originaux”. Les humains sont coincés dans des cocons de toiles jusqu’à ce que mort s’ensuive et nombreux sont les squelettes – la population originale de la ville, remplissant les catacombes.
Naturellement, la bête va tenter d’empêcher les protagonistes de fuir par tous les moyens, générant tout une foule d’individus dont l’apparence va se dégrader avec le temps et les agissements des héros pour les contrer: un personnage va littéralement fondre en une flaque visqueuse avant de se recomposer partiellement, avec une main tentaculaire qui lui vaudrait une belle place dans L’Antre de la Folie.

Des clones des parents disparus interviennent pour s’emparer du petit frère, lequel va arracher bras et mains avec une portière de voiture. L’ainé balance un revolver sur un type et l’arme se fiche littéralement dans son visage. Un brûlé revient avec une tête de mutant reptilien comme s’il n’avait pas pu se reconstituer correctement. Les plaies sont moches, gluantes et avec des morceaux, et si le liquide vert n’avait pas été utilisé pour simuler le sang de monstre, Phantom Town n’aurait absolument pas pu passer la censure, ou aurait traumatisé tout une génération de jeunes spectateurs.
Il faut dire que le scénariste se lâche et injecte tout un tas d’idées délirantes à ce qui n’aurait pu être qu’une simple histoire de cowboys fantômes. Pour prouver sa théorie comme quoi Long Hand est une seule entité, le frère cadet sort un couteau et tranche différentes surfaces pour voir si elles saignent. Comme le monstre ne peut absorber des organismes contre leur gré, il est contraint de soumettre ses victimes à une forme d’accord et nos héros réalisent que le registre de l’hôtel est un piège: tentant de le retrouver afin de le détruire, ils voient l’objet se faire pousser des pattes d’araignées pour prendre la fuite ! Il y a aussi cet œil géant dans les souterrains, pas loin d’un prototype du violeur Killer Eye, surtout lorsqu’il utilise lui aussi des tentacules pour maitriser ses proies. Le globe oculaire sera crevé d’un coup de feu on ne peut plus graphique, mais continuera quand même de se montrer belliqueux. En gros Benjamin Carr s’éclate, ne se limite absolument pas et en rajoute tellement que la sauce ne prend pas toujours.

Ainsi la ville étant une créature Lovecraftienne et organique, pourquoi faut-il s’endormir pour la rencontrer ? Bien sûr cela évoque les fameux songes de Cthulhu, mais ce n’est absolument pas exploité ou expliqué ici – d’ailleurs les protagonistes s’enfuient tout-à-fait normalement alors que la créature n’est pas encore morte. Difficile de comprendre la nécessité d’une promesse pour ingérer les proies alors qu’on découvre plus tard que des choses non organiques peuvent être assimilées. La nature mystique de l’Indien tient du cliché mais se raccorde difficilement avec le reste, à moins que cet univers ne mélange êtres antédiluviens et spiritisme chamanique.
Difficile également de gober cette histoire d’ancien serpent géant dont la dent contiendrait encore “beaucoup de poison”, servant surtout à tuer la créature et à donner quelque chose à faire au personnage de la petite sœur. Une gamine si jeune qu’elle apparait peu, ne pouvant évidemment “jouer” et qui n’a rien à faire de tout le film. Tant qu’à faire j’aurai préféré qu’elle soit plus âgée et incarnée par cette jolie figurante en bellyshirt que l’on aperçoit en début de film, mais cela aurait nécessité de revoir la classification du film. Surtout avec le pseudo Killer Eye et ses appendices… Pas très bon également ces quelques CGI primitifs utilisés pour certains effets trop ambitieux au regard du budget. Des habitants se liquéfiant entièrement, ou des flaques de slime qui prennent forme physique. Des humains “générés” spontanément, sortant des murs d’une bâtisse. L’aspect final de l’abomination, présentée comme une grosse boule d’énergie colorée façon jeu vidéo…

Pas parfait, mais sans importance. Ces ratages sont insignifiant au regard des bons points que cumule Phantom Town: des effets spéciaux à l’ancienne, du gore visqueux, un hommage à Lovecraft, des personnages passables mais pas horripilant et un épilogue que n’aurait pas renié Claudio Fragasso tant il évoque celui de Troll 2 ! Jugez plutôt: la famille organise une petite fête et, alors que les parents découpent un beau gâteau, la petite sœur réalise qu’un liquide vert s’échappe de celui-ci. Les “parents” sont des imposteurs, en fait des blobs sous formes humaines qui s’embrassent goulûment, laissant couler partout leur bave colorée. Hurlement des enfants, freeze frame, générique. L’amateur de Bruno Mattei sera à son comble tandis que ses gamins resteront sûrement perturbés.
Saluons également une courte durée (75 minutes) permettant un rythme soutenu, et vous obtenez un bon point d’entrée dans le genre horrifique pour tous les plus jeunes et les néophytes, doublé d’un parfait substitut aux séries télé adaptées de R.L. Stine. A noter par ailleurs que tout ceci fut mis en boite par Jeff Burr, responsable en son temps de quelques grosses série B comme Massacre à la Tronçonneuse III ou La Nuit de l’Épouvantail… S’il n’est pas toujours facile de mettre la main sur le film, entre autre parce qu’il s’agit d’une petite production issue d’un obscure label de la Full Moon mais aussi parce qu’il possède de multiples titres, cela en vaut néanmoins la peine. Ce n’est pas tous les jours que l’on trouve une telle pépite…

GALERIE



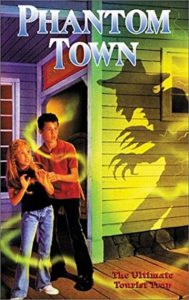
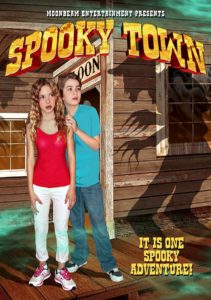





Commentaires récents